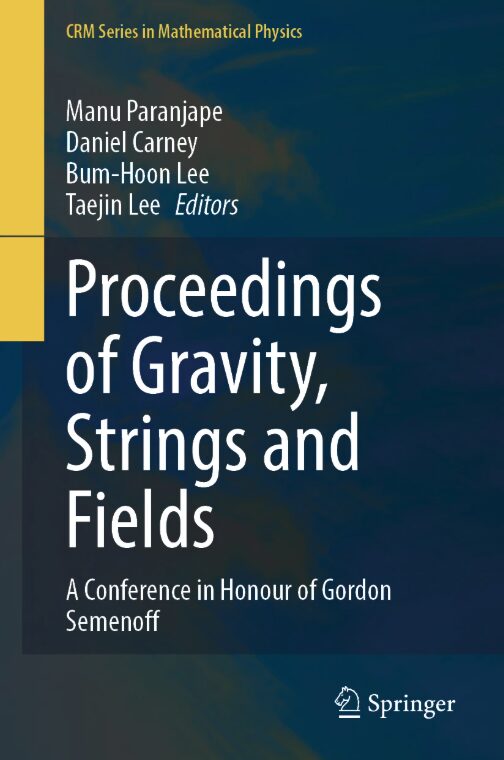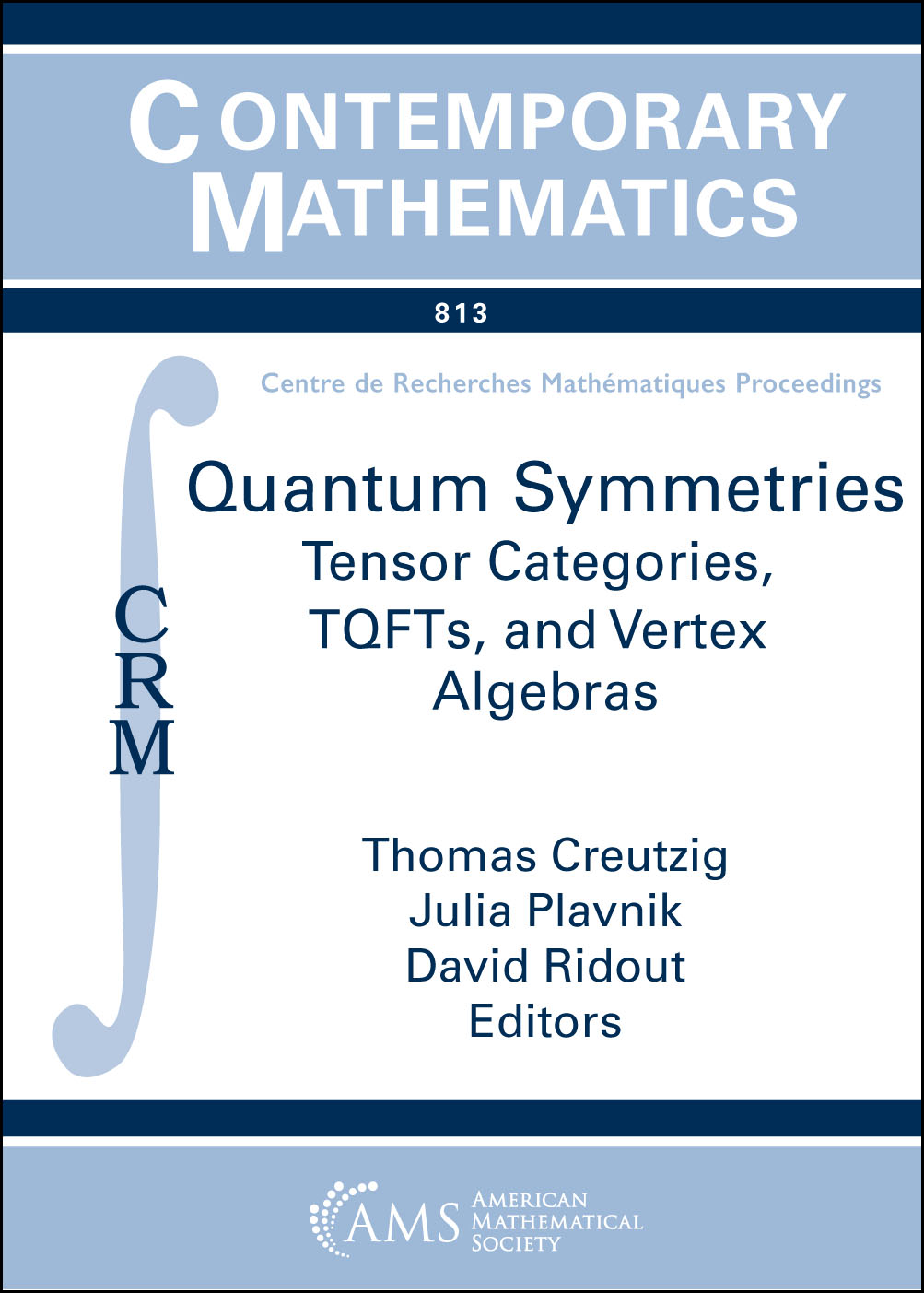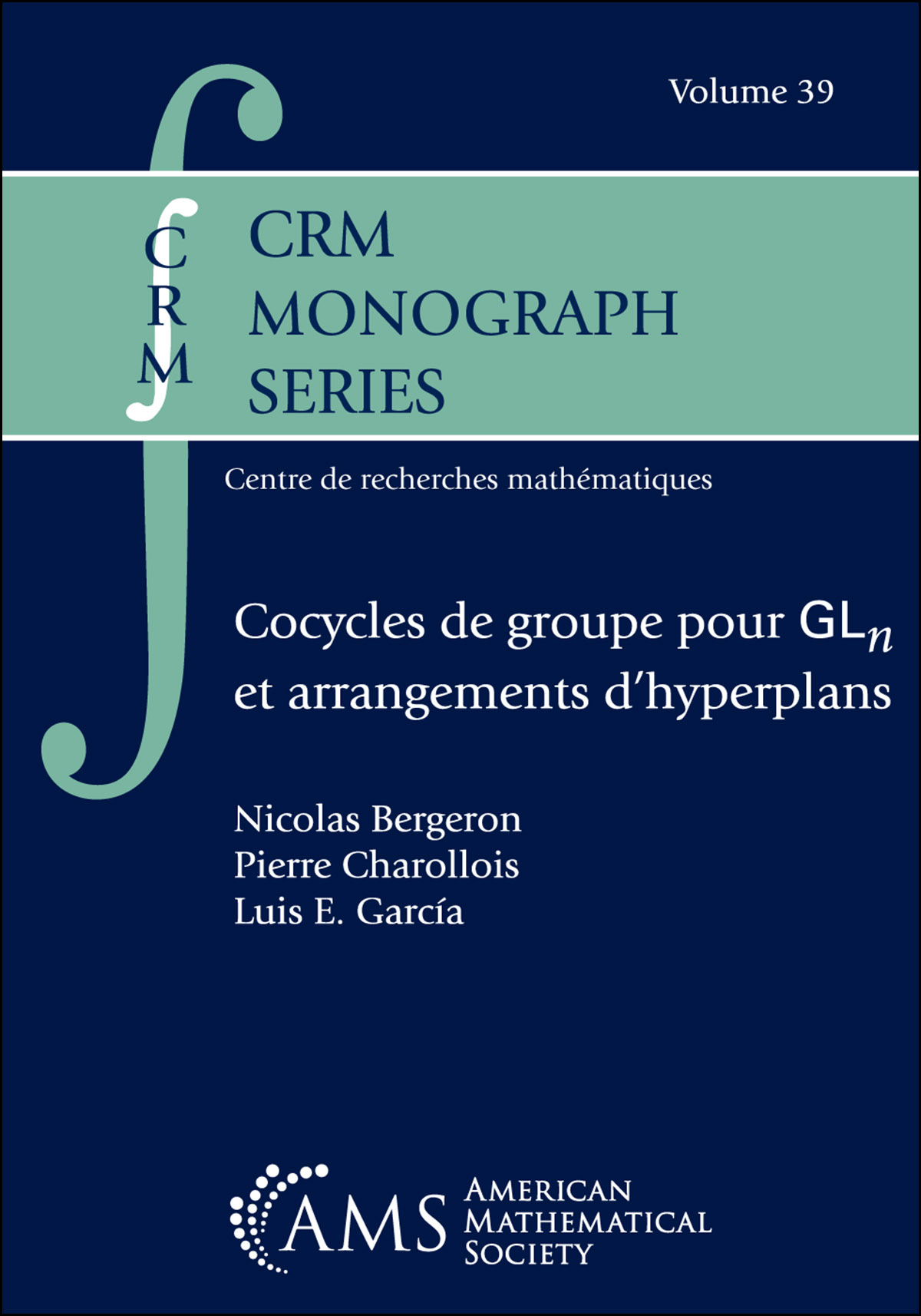Gouvernance
Comité scientifique international
Le comité scientifique international conseille le CRM sur les grandes orientations scientifiques. Il contribue notamment à la mise sur pied et à l’élaboration des programmes thématiques (programmes annuels, semestriels et programmes courts), à l’élaboration du programme scientifique général et multidisciplinaire, ainsi qu’à toute autre activité scientifique majeure du Centre.
Le comité se réunit au CRM au moins une fois par année et est également consulté plusieurs fois par année par visioconférence et par courrier électronique.
Membres
- Lia Bronsard (McMaster University)
- Pierre Colmez (Université Pierre et Marie Curie)
- Panagiota Daskalopoulos (Columbia University)
- Eugenia Malinnikova (Stanford University)
- André Arroja Neves (University of Chicago)
- Robert Pego (Carnegie Mellon University) — président du comité
- Jeremy Quastel (University of Toronto)
- Vic Reiner (University of Minnesota)
- Emmanuel Royer (CNRS)
- Franco Saliola (Université du Québec à Montréal)